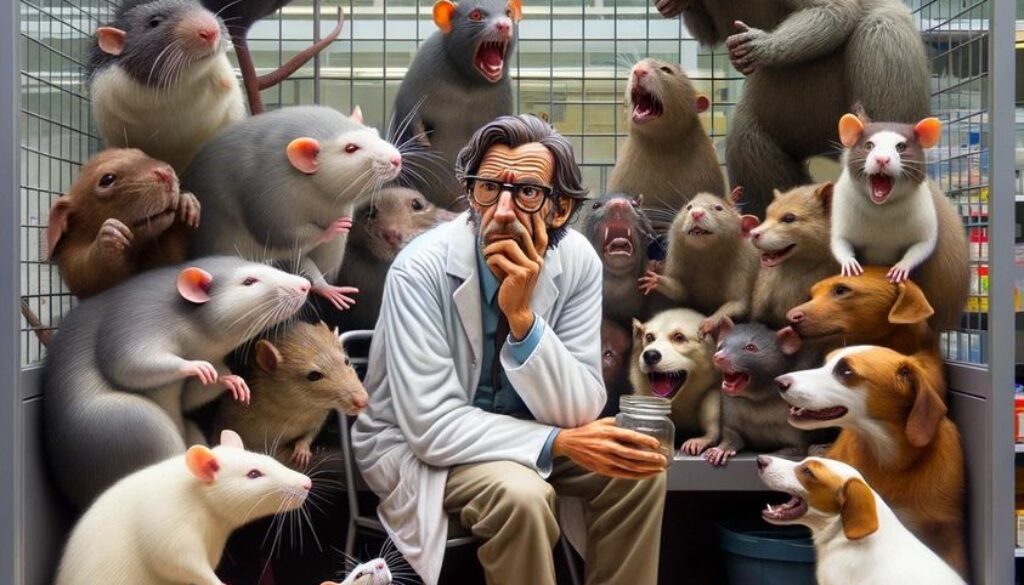Expérimentation animale et progrès médical
Expérimentation animale et progrès médical
C’est une affirmation à laquelle nous sommes souvent confrontés : expérimenter sur des animaux a permis de découvrir nombre de médicaments, thérapies ou vaccins dont nous bénéficions encore aujourd’hui et l’interdire porterait un coup d’arrêt au progrès médical. Pour preuve, nous dit-on, un grand nombre de Prix Nobel de physiologie ou médecine ont été décernés à des chercheurs ayant fait leurs découvertes en expérimentant sur des animaux.
Il fallait puiser dans l’histoire de la médecine des exemples de découvertes importantes où des chercheurs ont, oui, expérimenté sur des animaux… mais après que les observations principales ont été faites sur l’être humain ! André Ménache s’y est attaqué, publiant le résultat dans trois tribunes intitulées : “Devons-nous à l’expérimentation animale nos soins médicaux ?” (1) “…plusieurs prix Nobel ? (2) “…les traitements de la maladie de Parkinson ?” (3). Nous vous proposons ici un condensé de ses arguments, à utiliser dans tout débat auquel vous participeriez et à diffuser sans modération !
Soins médicaux
Pour justifier leurs travaux, les chercheurs qui expérimentent sur des animaux utilisent trois arguments de façon récurrente :
1. Il est nécessaire d’utiliser un système vivant entier pour étudier le fonctionnement du corps ainsi que pour étudier les maladies.
2. Les méthodes dites « alternatives » ne sont pas suffisamment au point pour remplacer toutes les expériences, notamment le système vivant entier.
3. Grâce à l’expérimentation animale, nous pouvons sauver des vies humaines.
Qu’en est-il vraiment ?
1. Les chercheurs insistent sur la nécessité d’un système vivant entier sans préciser l’identité de ce système vivant. Un chien est un système vivant ; un singe est un système vivant différent. Les chercheurs qui utilisent des animaux mettent en avant les « similitudes ». Ce mot a un sens que chacun peut comprendre dans la vie quotidienne. Mais en quoi un chien ou un singe sont-ils semblables à nous sur le plan biologique ? Les êtres vivants sont des systèmes complexes qui sont très dépendants de leur propre patrimoine génétique. Ainsi, on ne peut prédire par l’observation la réaction physiologique d’un système complexe par rapport à un autre.
2. Les méthodes “alternatives”, que l’on nous dit insuffisantes, se perfectionnent de plus en plus. Pour l’étude des maladies humaines, on dispose de très nombreuses techniques dont l’utilisation de déchets chirurgicaux destinés à l’incinération, les cultures de cellules humaines, les organes sur puce (et même l’humain entier sur puce), l’imagerie non invasive de patients ou de personnes saines se prêtant à la recherche biomédicale, les données cliniques (observation des malades), etc.
3. Dans quelle mesure des expériences faites sur des animaux ont-elles permis de découvrir des traitements salvateurs pour l’être humain ? L’historien de la médecine Brandon Reines met en lumière le véritable rôle de l’expérimentation animale pour entériner des hypothèses formulées par des cliniciens et des chirurgiens et ensuite reproduites par des chercheurs utilisant des animaux dans le but de “confirmer” ou de “valider” ce qui a déjà été observé dans un contexte clinique réel chez l’homme.
Quant à la recherche fondamentale (entreprise « sans qu’aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues »), elle pourrait aussi se faire sans animaux pour autant que les chercheurs choisissent cette option. Le public soutiendrait-il l’utilisation d’animaux s’il savait que beaucoup d’expériences sont faites sans rapport avec la préservation de la santé humaine ?
Prix Nobel
Des faits historiques éclairent les véritables processus de découvertes scientifiques et médicales majeures. Par exemple, des observations de Galien (129-216 apr. J.C.) sur la physiologie du système circulatoire basées sur des dissections d’animaux seront remises en question en 1242 lors de la publication du « Commentaire sur l’anatomie dans le Canon d’Avicenne » par Ibn-al-Nafis. Ce dernier décrit la découverte de la circulation pulmonaire chez l’homme.
Si des expériences sur des animaux ont pu avoir lieu au cours du processus d’une découverte médicale, cela ne signifie pas qu’elles aient joué un rôle déterminant ni que la découverte n’aurait pas pu avoir lieu sans elles. Considérons l’exemple de la découverte de l’insuline. En 1923, le Dr Frederick Banting recevait le Prix Nobel de physiologie ou médecine pour cette découverte. Il avait bloqué le canal pancréatique de chiens, empêchant ainsi la sécrétion d’insuline. Mais qu’est-ce qui avait précédé et inspiré cette expérience ? En 1788, le Dr Thomas Cawley faisait le lien entre les symptômes du diabète et un taux de sucre élevé dans les urines. Un siècle plus tard, le biologiste Paul Langerhans découvre, au microscope, les cellules du pancréas qui produisent l’insuline. En 1920, le Dr Banting lit un article décrivant l’autopsie d’un patient diabétique dont le canal pancréatique était obstrué par des calculs… d’où l’idée de vérifier sur des chiens !
Beaucoup d’avancées médicales majeures ne doivent rien à l’expérimentation animale. Par exemple, la plupart des premiers psychotropes ont été découverts par hasard alors qu’ils étaient prescrits pour d’autres effets. L’isoniazide était utilisé pour traiter la tuberculose ; la chlorpromazine était un adjuvant anesthésique ; les phénothiazines sont issues de la recherche de préanesthésiques. Des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), anti-dépresseurs modernes, ont été mis au point grâce à un processus de conception rationnelle de médicaments, laquelle s’appuie sur plusieurs disciplines ayant connu un grand essor dans les dernières décennies (biochimie, génomique, modélisation informatique, etc.). Elle est aujourd’hui le principal moteur du développement des médicaments.
Traiter la maladie de Parkinson
Dans les années 1950, des chirurgiens suédois pratiquaient des ablations à des endroits précis du cerveau pour réduire les symptômes de la maladie. Une zone cérébrale critique était donc identifiée chez l’homme.
Aux États-Unis, le Dr George Cotzias testait la D.L-DOPA pour tenter de rétablir la fonction d’une zone cérébrale appelée “substance noire” chez des patients. Le Dr Hornykiewicz s’est inspiré de ces études pour mesurer le taux de dopamine sur le cerveau post-mortem de patients atteints de la maladie de Parkinson, ce qui mènera au premier essai clinique de L-DOPA en 1961.
En 1976, un étudiant en chimie s’injecte du MPPP, un opioïde utilisé par des toxicomanes, qu’il avait synthétisé de manière incorrecte. Son injection était contaminée par une autre substance, le MPTP. Trois jours plus tard, il développait des symptômes de la maladie de Parkinson. Après cet accident de laboratoire, un “modèle animal” de la maladie de Parkinson sera trouvé : injecter du MPTP à des singes. Modèle bien imparfait puisque les symptômes sont provoqués sur les animaux de façon brutale alors que la maladie humaine de Parkinson est chronique et d’évolution lente.
Des milliers de singes subiront dès lors l’implantation d’électrodes dans le cerveau, ouvrant la voie à des essais de stimulation cérébrale profonde, une découverte vantée par les défenseurs de l’expérimentation animale. Pourtant, le concept de stimulation cérébrale profonde a été développé dans les années 1960 avec l’utilisation de microélectrodes pour enregistrer l’activité électrique de fibres nerveuses individuelles du thalamus (une structure cérébrale) de patients atteints de la maladie de Parkinson, bien avant la création du modèle singe MPTP (4). Pratiquée sur l’être humain en tant que méthode thérapeutique, la stimulation cérébrale profonde est une intervention chirurgicale non sans risque d’hémorragies, de réactions allergiques ou de déplacement de l’électrode implantée dans le cerveau. De nouvelles approches de stimulateurs cérébraux intelligents sont testées sur des patients humains car il n’y a pas d’alternative capable de s’adapter aux changements de comportement du cerveau de chaque patient au cours du temps ni à l’évolution de la maladie.
Le public est porté à croire que la recherche de traitements représente la meilleure stratégie pour faire avancer la médecine. Mais quand on sait que l’exposition à certains pesticides ou solvants augmenterait de façon significative le risque de développer une maladie de Parkinson, pourquoi négliger la prévention ?
1. Le 24 juillet 2025 : https://blogs.mediapart.fr/andre-menache/blog/240725/devons-nous-lexperimentation-animale-nos-soins-medicaux
2. Le 24 septembre 2025 : https://blogs.mediapart.fr/andre-menache/blog/240925/devons-nous-lexperimentation-animale-plusieurs-prix-nobel-0
3. Le 7 octobre 2025 : https://blogs.mediapart.fr/andre-menache/blog/071025/devons-nous-lexperimentation-animale-les-traitements-de-la-maladie-de-parkinson
4. https://antidote-europe.eu/publications-presse-scientifique/ ; référence N°13 « Commentary: Lessons from the Analysis of Non-human Primates for Understanding Human Aging and Neurodegenerative Diseases « , par André Ménache et Anne Beuter