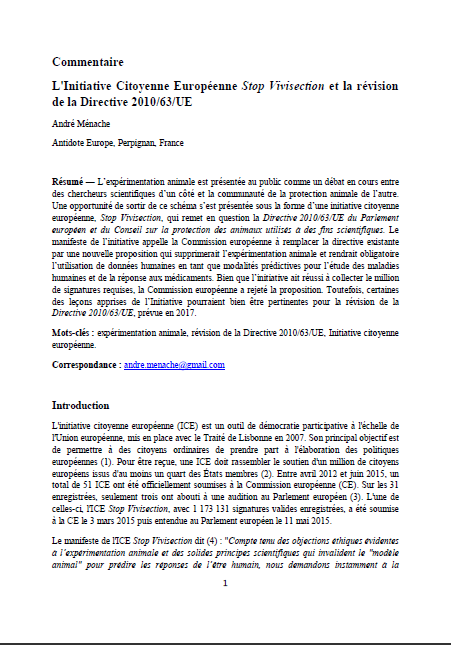La mairie de Vandœuvre soutient le débat
C’est une première en France. Une mairie soutient publiquement la demande d’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur la validité du « modèle animal ». La Ville de Vandœuvre se propose aussi de mieux s’informer sur les activités en recherche animale de l’Université de Lorraine.
 Cet article fait suite à celui que nous publiions le 8 novembre 2016 (https://antidote-europe.eu/moderniser-universite-de-lorraine/), quelques jours après notre conférence à Vandœuvre-lès-Nancy. Nous vous rendions compte de la pétition lancée par International Campaigns, de notre conférence et de notre lettre au président de l’Université de Lorraine, M. Pierre Mutzenhardt.
Cet article fait suite à celui que nous publiions le 8 novembre 2016 (https://antidote-europe.eu/moderniser-universite-de-lorraine/), quelques jours après notre conférence à Vandœuvre-lès-Nancy. Nous vous rendions compte de la pétition lancée par International Campaigns, de notre conférence et de notre lettre au président de l’Université de Lorraine, M. Pierre Mutzenhardt.
De M. Mutzenhardt, nous n’avons reçu aucune réponse. Par contre, notre collaboration avec des conseillers municipaux commence à porter de beaux fruits. Une conseillère en charge de questions de santé est particulièrement attentive à nos arguments.
Le 23 janvier 2017, une « motion concernant les travaux scientifiques menés dans le centre d’expérimentation animale de l’Université de Lorraine » était adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal de Vandœeuvre-lès-Nancy.
Le vrai rôle des comités d’éthique
Sans reproduire intégralement le procès-verbal des délibérations et la motion qui est lue et présentée par la Ville de Vandœuvre sur son site (http://www.vandoeuvretv.fr/VOD/Conseil-municipal), notons les extraits suivants :
« Considérant que la municipalité de Vandœuvre est à la fois sensible à la souffrance animale, mais aussi à l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients et au progrès de la médecine de manière générale, »
« Le Conseil Municipal demande :
– Qu’une personnalité du monde scientifique, reconnue pour ses compétences dans le domaine des méthodes de substitution, ainsi que dans celui de la médecine vétérinaire et de la protection animale, siège au sein du comité d’éthique.
– Que les différents membres du Comité d’Ethique Animale puissent contrôler le fonctionnement du centre d’expérimentation animale et visiter ses locaux à la demande. »
Comme le relate L’Est Républicain du 24 janvier 2017, un chercheur de l’Université de Lorraine a bien tenté de s’opposer à cette motion, accusant la mairie « d’ingérence« . Pourtant, dans la mesure où ces comités d’éthique sont bien prévus par la loi, où serait l’ingérence ? La mairie de Vandœuvre ne demande ni plus ni moins que l’application de la loi (transposition de la directive européenne 2010/63/UE) et entend veiller à ce que le comité d’éthique de l’Université de Lorraine ait un fonctionnement efficace.
Membre de plusieurs comités d’éthique, notamment en Belgique et en Suisse, André Ménache a pu constater leur dysfonctionnement. Un chercheur opposé à l’utilisation d’animaux est systématiquement mis en minorité lors des votes qui approuvent invariablement les expériences sur des animaux. Ses arguments scientifiques ne sont pas entendus et les méthodes de substitution qu’il propose, inconnues des chercheurs qui demandent à utiliser des animaux, ne seront pas imposées.
Arrêtons-nous encore sur l’importance de ce terme : « méthodes de substitution ». Nous nous référons à des méthodes n’impliquant aucun recours à l’expérimentation animale et utilisant, à la place, des cellules humaines par exemple. Or, les autorités emploient trop souvent le terme « méthodes alternatives », qui peut aussi bien recouvrir des méthodes qui supposent l’utilisation de moins d’animaux, ou d’animaux jugés moins sensibles, mais qui ne suppriment pas forcément le recours à l’expérimentation animale.
Dans l’interview qu’il a accordée à Antidote Europe, le professeur Marco Mamone Capria témoignait, lui aussi, du dysfonctionnement du comité d’éthique dont il était membre (https://antidote-europe.eu/comites-d-ethique-marco-mamone-capria/).
On constate que la directive 2010/63/UE ne modère nullement l’utilisation d’animaux. Bien au contraire, sous couvert de se conformer à ses dispositions, les chercheurs obtiennent facilement un blanc-seing pour pratiquer l’expérimentation animale. La motion adoptée par la mairie de Vandœuvre seule ne pourra pas contrer cette tendance tant qu’il n’y aura qu’un seul scientifique capable de proposer des méthodes de substitution. Mais si chaque mairie concernée faisait pareil, les chercheurs voulant pratiquer l’expérimentation animale sauraient, du moins, que leur demande au comité d’éthique ne serait pas une simple formalité et qu’ils auraient intérêt à chercher par eux-mêmes les méthodes de substitution disponibles.
Vers un débat scientifique
La dernière partie de la motion adoptée par la mairie de Vandœuvre nous fait particulièrement chaud au cœur puisqu’elle soutient notre principale action de cette année :
« – Que la commune soit associée à la demande d’enquête parlementaire initiée ces dernières semaines et dont le but serait, en rassemblant des experts scientifiques, d’ouvrir le débat sur la validité du modèle animal. »
Nos très chaleureux remerciements et félicitations à M. Stéphane Hablot, maire de Vandœuvre, qui a signé cette motion et en a été le rapporteur, ainsi qu’à tous les conseillers municipaux qui ont participé à ce travail.